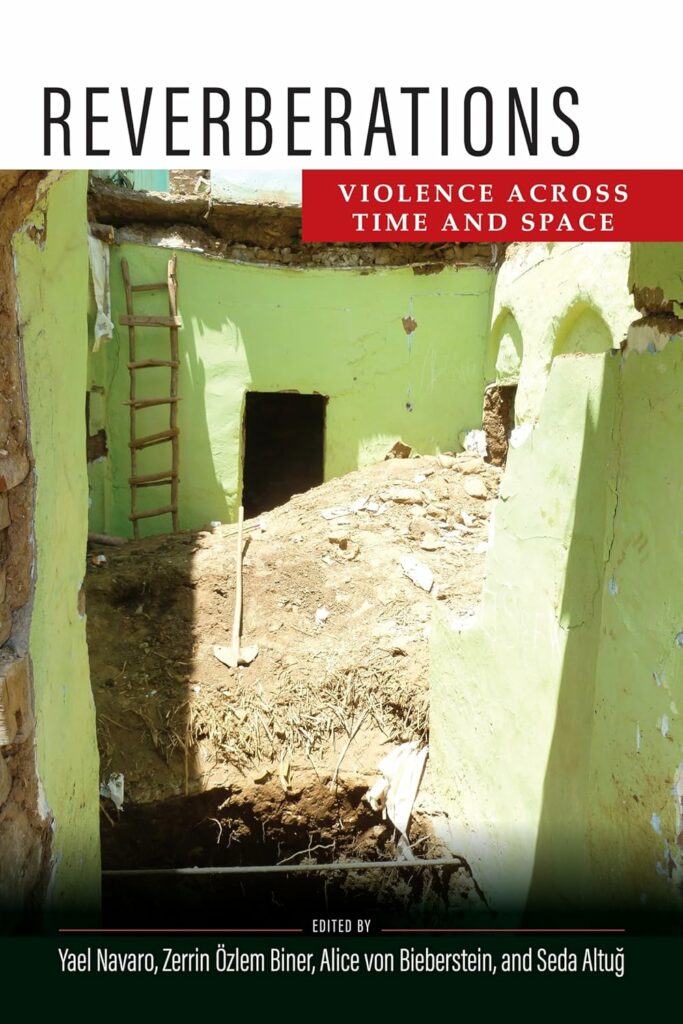Par Verda Kimyonok, doctorante en anthropologie à l’EHESS, IRIS, boursière AMI/IFEA.
Egalement disponible sur le carnet Hypothèses de l’OVIPOT.
Il y a deux ans, je découvrais l’ouvrage Reverberations: Violence Across Time and Space. The Ethnography of Political Violence[1]. Depuis, cet ouvrage collectif revient sans cesse dans mes lectures et mon terrain de recherche. Mon travail sur les pratiques patrimoniales et leur transmission chez les alaouites de Samandağ (Hatay, Turquie) me mène inévitablement à explorer le lien entre territoire et existence[2]. Je souhaite par cette recension traduire les interrogations et les approches du terrain développées dans cet ouvrage qui résultent d’un long effort collectif. Pour cela, j’ai fait le choix de me focaliser sur l’introduction et les chapitres des quatre co-éditrices de l’ouvrage. L’ouvrage comporte également des chapitres rédigés par Rosalind C. Morris, Connie Gagliardi and Valentina Napolitano, Munira Khayyat, Hanna Baumann, Erdem Evren, Shannon Lee Dawdy, Eray Çaylı and Penelope Harvey, qui ne sont pas traités ici.
Je commencerai donc par une rapide présentation des autrices. L’historienne Seda Altuğ rattachée jusqu’à récemment à l’Université de Boğaziçi[3], a fait son doctorat sur le sectarisme, la violence et les mémoires pendant le mandat français en Syrie. Son domaine de recherche porte sur les relations entre l’État et la société en Syrie française, les questions foncières, l’empire, les minorités, les frontières. Elle étudie aujourd’hui les mécanismes de la politique coloniale de différenciation et de gestion de la population par le biais de la gouvernance des terres, publiant plusieurs articles à ce sujet.
Alice von Bieberstein est enseignante au Centre de recherche anthropologique sur les musées et le patrimoine, à l’Institut d’ethnologie européenne, Humboldt-Universität zu Berlin (Allemagne). Elle étudie les divers héritages du génocide des arméniens, parmi lesquels les transformations du paysage, mais aussi la gouvernance biopolitique des minorités et les engagements pratiques avec les vestiges matériels du passé arménien de la région, en particulier par le biais de la « chasse au trésor » (definecilik). Cette pratique, réputée en Turquie, repose sur la croyance de l’existence de trésors enfouis par les arméniens avant leur déportation.
Zerrin Özlem Biner est maîtresse de conférences en anthropologie au département d’anthropologie de SOAS (Royaume-Uni), et directrice du Centre for Migration and Diaspora Studies. Ses recherches se concentrent sur les thèmes de l’État, de la citoyenneté, de la violence politique, des déplacements et retours forcés, de la mémoire, du patrimoine et de la propriété, des communautés diasporiques, des citoyens et réfugiés issus de minorités ethniques et religieuses. Elle s’intéresse aux processus de réconciliation et aux pratiques de solidarité dans les situations de conflit et d’après-conflit. Elle a également écrit States of Dispossession: Violence and Precarious Co-existence in Southeast Turkey (University of Pennsylvania Press, 2020), qui jalonne l’itinéraire de son enquête de terrain pour Reverberations.
Enfin, Yael Navaro est professeure en anthropologie sociale à l’Université de Cambridge. Elle s’intéresse à la politique, l’État, ainsi qu’à la violence et ses répercussions. Elle a contribué à l’élaboration d’une approche affective, spatiale et matérielle de l’étude des environnements post-conflit. Son travail s’est concentré tout d’abord sur la vie sociale et politique en Turquie et à Chypre, puis s’est étendu à l’ensemble de la région, traitant des questions de représentation et d’effacement des populations minorisées. Elle a notamment écrit Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey (Princeton University Press, 2002), un ouvrage de référence sur la culture politique et la vie publique dans le contexte des années 1990 en Turquie et à Istanbul.
Yael Navaro et Zerrin Özlem Biner se sont toutes deux intéressées dans les années 2000 à la violence post conflit liée à la « question kurde » dans le Sud-Est de la Turquie. Elles ont alors entrepris de réfléchir ensemble à leur positionnement sur ce terrain qui s’ouvrait à nouveau, après la guerre de 2015-2017, aux chercheur-euses et aux regards extérieurs. En 2015, rejointes par Alice von Bieberstein et Seda Altuğ, elles ont débuté un projet, financé par un fond de recherche du Conseil de Recherche Européen (ERC), intitulé Living with Remnants: Politics, Materiality and Subjectivity in the Aftermath of Past Atrocities in Turkey (2012-2016)[4]. Ce projet consiste en un ensemble de réflexions sur la violence de masse et ses répercussions sur le terrain de recherche ethnographique, à travers la géographie de l’Empire ottoman et plus particulièrement le Sud-Est de la Turquie. Il a donné lieu à de nombreuses conférences et communications, dont celle organisée à Galata Greek School en 2015 à Istanbul, donnant l’idée de cet ouvrage[YB1] [VK2] .
Publié en 2021, l’ouvrage est divisé en trois parties thématiques (Spaces of Death, Violence and the Supernatural, Violence Against Nature and Infrastructural Violence), et contient onze chapitres. L’originalité de ce travail réside dans l’exploration de la matérialité de la violence dans ses réalités à la fois temporelles et spatiales. Si l’introduction pose des difficultés pour tout lecteur peu familier avec les théories post-humanistes, je m’attache dans cette recension à restituer ce que je comprends de l’exploration de ces nouveaux concepts. Je présenterai ici quelques-unes des notions clés qui structurent le fil conducteur de ce travail de recherche.
Comment peut-on voir les traces de la violence, lorsque celle-ci est immatérielle (intangible, immaterial), et / ou qu’elle ne laisse que de fines traces ? Les dimensions raciales et de genre nous rappellent que les effets de la violence sont omniprésents, marquants (sur les corps et les esprits), et qu’ils s’inscrivent dans des utilisations (par exemple, celui de la discipline) et des cadres sociopolitiques (la hiérarchie des classes sociales). Comme le rappelle McIntosh, une fois établi que le racisme était un système oppressif, il fallut un tout autre processus pour comprendre ce qu’il signifiait, à savoir que « d’autres jouissent de privilèges » (McIntosh cité dans Ünlü, 2016). Ainsi, s’il y a des victimes, il y a bien sûr des coupables. Mais il existe surtout un cadre plus large qui permet ce mécanisme. Au lieu de s’évertuer à chosifier les potentielles victimes et coupables, Reverberations se détourne des catégorisations classiques pour se demander quels et où sont les résidus de la violence. Les co-autrices espèrent aller au-delà d’une lecture qui situe « la violence comme existant uniquement dans la relation intersubjective asymétrique entre l’auteur [de la violence] et la victime (Mamdani 2001) » (p. 13).
Discuter de concepts tels que celui de « responsabilité » révèle la dualité et la violence inhérente aux usages des concepts comme des catégories. Les mots et pensées objets, socialement construits, souvent figés, font partie intégrante de « régimes de pouvoir » (regimes of power) qui comprennent des oppositions et hiérarchies spécifiques. En proposant d’étudier la « complicité », les co-éditrices déplacent le focus et permettent de dépasser dénis et discours lissés. Au travers de ces deux concepts, le génocide arménien est pensé comme une « accumulation privative », une « dépossession » qui mène à une transformation en arme (weaponization[5]). L’ouvrage approfondit également les concepts de matérialité, de subjectivité et de violence dans leur « distribution, [leur] extension et endurance » (p. 2)[6]. Il développe ces notions en tant que « suites » (en anglais aftermath, conséquences, répercussions) dans le temps et l’espace.
L’introduction s’attache à contextualiser ces concepts et leurs usages dans l’ère post-humaniste tout en proposant de nouvelles approches. Le post-humanisme consiste en la remise en question du « principe de l’exceptionnalisme humain, reposant ainsi la question de l’agentivité ou capacité d’action (agency) » (Latour 2005, Benett 2010 cités p. 7). Les autrices investissent ce courant tout en adoptant une posture critique. En effet, elles étendent l’action au-delà de celle, seule, de l’humain, en engageant « ce volume dans une sensibilité post-humaniste envers les choses non humaines, les paysages, les infrastructures, le sous-sol, la matière et les êtres plus qu’humains (more-than-human beings) ». Toutefois, les co-éditrices considèrent que la violence politique a été trop absente des réflexions menées jusqu’alors au sein de ce même courant. Elles soulignent également que la souffrance et la mort sont trop souvent extériorisées, « en particulier dans les deux courants de la pensée post-humaniste, les nouveaux matérialismes et le tournant ontologique ». En concevant l’existence de cette manière, les rigidités qui en découlent ont pu encourager une lecture de l’histoire en termes d’« événements » et de « ruptures ». Cette approche a eu pour effet de figer et de fragmenter certains moments, aussi bien dans le passé que dans le présent. À l’inverse, ce travail collectif cherche à révéler des domaines qui étaient jusque-là peut-être invisibles — ou rendus invisibles — par ces cadres empiriques et conceptuels.
Ce processus d’intelligibilité de la violence dans un contexte sociopolitique donné nécessite de s’appuyer sur des éléments souvent invisibles, tels que les systèmes, les affects, les imaginaires… Il se nourrit aussi des retours d’expériences de terrains traitant de la violence en anthropologie (voir Lefranc 2002, Naepels 2019). Mais le détachement et la fluidité de l’analyse présentée dans Reverberations éclairent les traces laissées par la violence, même là où celle-ci semble avoir été effacée, et tranchent ainsi avec les contributions issues mouvement post-humaniste. C’est ici, je pense, que la méthodologie du négatif (negative methodology, p.11 et Navaro 2020), est la mieux saisie. Cet effort pour dépasser les catégories binaires[7] habituellement utilisées dans la recherche, comme des boîtes trop englobantes ou restrictives, ou « corrompues » par des principes contextuels (p.121), se retrouve tout au long de l’ouvrage.
Parmi les nombreux concepts abordés, l’ouvrage introduit les « vestiges » (ou « restes », remnants en anglais) pour parler de la résidualité (im)matérielle de la violence dans les relations politiques et sociales, en particulier celle liée au déni et à la complicité. Ce terme, marquant une prise de position (la violence ne disparaît pas une fois l’action finie : elle est structurelle), souligne que les usages ne sont jamais neutres, aussi bien dans le contexte de la République de Turquie, que dans celui des conflits intercommunautaires dans le pays ou encore au sein de sa diaspora (p. 9). De même, le terme « réverbérations » (échos, répercussions) est utilisé pour penser « la persistance à long terme de la violence » (p. 10) en insistant sur un « continuum de la violence » toujours en cours. Avec une approche originale, l’ouvrage intègre aussi une analyse géographique de la violence. Ainsi, la terre (land) se trouve au cœur des matérialités de ces violences. Elle est tantôt une condition du déni, tantôt une preuve de souveraineté. Les modalités de propriété, de dépossession et de revendication sur la terre révèlent des dissonances spatiales et temporelles. Parler de vestiges et de réverbérations permet de redonner toute sa matérialité à la violence, en tant que pratique quotidienne et socialement acceptée, tout en la reliant aux imaginaires, représentations et usages qui en témoignent — et qui sont, en partie, produits par elle.
Examinons à présent quelques notions importantes mentionnées dans le livre. À travers les chapitres étudiés, le travail d’enquête vient préciser certains caractères du sécularisme (turc), [YB3] [VK4] héritier des violences envers les minorités à l’origine de la fondation d’une Turquie moderne à l’ère post-coloniale. C’est pourquoi une analyse historique des impacts du sectarisme (représentation de la religion dans laquelle ce sont les identités religieuses décontextualisées qui définissent les individus, voir p. 105 et Makdisi 2000 cité dans le livre) sur les territoires permet de mieux comprendre les dynamiques de production de la différence socioculturelle. Enfin, un autre exemple est celui de definecilik conçue « comme un investissement spéculatif dans la mort, une mort qui est historique », celles des Arméniens en 1915. Production du génocide, « la chasse au trésor marque l’excès matériel-économique qui n’a jamais pu être domestiqué au sein d’une économie nationale turque fondée sur le transfert massif de richesses non-musulmanes » (p. 64).
Après la présentation du cadre conceptuel, je reviendrais rapidement sur les chapitres écrits par les co-autrices. Le chapitre 2, « Spéculer sur la mort. La chasse au trésor dans le Moush d’aujourd’hui », dresse un tableau des biens et des ruines arméniens qui portent les marques de la destruction, de l’absence et de la spoliation sous l’emprise des hommes et du temps. Alice von Bieberstein affirme ici que definecilik « s’inscrit dans une histoire de pillage qui constitue la dimension économique de la violence fondatrice de la République de Turquie », « comme le vecteur matériel qui retrace les réverbérations de la violence génocidaire de 1915 jusqu’à notre époque actuelle » (p. 63). Dans ce chapitre qui se déroule dans un territoire à la population kurde, elle établit un lien entre les séquelles du génocide arménien et la spéculation, la masculinité et les valeurs nationales.
Dans le chapitre 3, « Culture de la Dépossession à la fin de l’empire Ottoman et les débuts de la République Turque : Terre, différence ethno-religieuse et violence », Seda Altuğ se concentre sur Beshiri et la région de Batman. Les témoignages de ce terrain ethnographique « révèlent comment la matérialité sous forme de topographie rurale ainsi que la dépossession des terres sont constitutives d’un sentiment de communauté et d’appartenance dans le monde post-génocide dans un cadre rural kurde à la fin des années 2010 » (p. 85). L’importance de la contextualisation prend ici toute sa force, illustrant la façon dont « la terre en tant que vestige matériel » révèle des continuums de violence. Ceux-ci émanent de la différenciation des statuts et droits de propriété et d’administration selon des paramètres religieux, créant les conditions et formes institutionnelles de la violence dans le temps. L’approche historique sur un terrain contemporain, à travers l’angle du statut de la propriété territoriale (land) – et plus largement l’espace – au sein du cadre étatique, témoigne ainsi de systèmes de valeur et de domination fondés sur l’appartenance religieuse ou ethnique à différentes époques.
Le chapitre 4 de Yael Navaro« Violence et spiritualité. Cosmographie de Khidr à l’interface territoriale turque/syrienne » se concentre sur Khidr[8], un prophète et être spirituel évoqué dans le Coran pour sa sagesse. Il est d’un apport important, car il existe peu d’études sur ce terrain. Le chapitre raconte les réapparitions de cet être dans l’espace et le temps, en particulier à la frontière lors des résurgences de violence (la guerre en Syrie). Yael Navaro met en lumière les défis posés par des décennies de marginalisation et de violence dans un contexte ethno-religieux minoritaire, celui des Arabes alaouites au sud de Hatay[9]. Dans ce terrain singulier, la laïcité à la turque (laiklik) et la territorialisation dans le cadre de la nation, menant à l’incapacité à penser l’entre-deux (in-betweennesses, aussi évoqué dans O’Rourke 2006), ont contribué à maintenir une perspective sectaire. Elles ont créé un monde de distinctions et d’oppositions sur les plans religieux, ethniques, politiques et géographiques. Néanmoins, la figure de Khidr est parvenue à rester en dehors des polarisations (« dépolarisée ») dans le paysage multiculturel local composé d’alaouites, chrétiens, et sunnites principalement. En revenant sur l’histoire et la symbolique spirituelle de Khidr, l’autrice dessine une figure qui dépasse les antagonismes et lignes de différenciation discursives entre politique et religion, rationnel et irrationnel, séculier et religieux dans les conversations de tous les jours (p.137).
Le chapitre 6 de Zerrin Özlem Biner, « Creuser. L’imagination spirituelle-matérielle de la (dé)possession à Mardin, Sud-Est de la Turquie » présente une ethnographie réalisée en 2013 et 2015 des « liens matériels, émotionnels et historiques entre les gens et les maisons en pierre » dans un contexte multiethnique où les habitant-es rencontrent la possession par les djinns. Son analyse considère les djinns comme les plus anciens résidents, ou transmetteurs (p.168) du lieu, d’où leur rôle dans la pratique de l’excavation (definecilik). Ils traduisent des complications dans « les relations entre le passé, le présent et le futur », comme agents perturbateurs, et mènent ainsi à questionner l’agentivité et la responsabilité. Les strates de la dépossession sont présentées à travers une restitution de l’histoire du patrimoine et de la démographie locale, du 19ème siècle jusqu’au temps de l’enquête. En situant la continuation des pratiques dans l’émergence de questionnements à une échelle globale concernant la valorisation et la protection du patrimoine local, l’autrice illustre une nouvelle période de réhabilitation et de conservation du patrimoine par les habitant-es. Celle-ci semble s’articuler avec l’état dans ses actions de reterritorialisation post-conflit, et se conformer aux logiques capitalistes.
Dans quelle temporalité s’inscrit l’imaginaire des populations dans les zones de violence ? Quelle est la perception de la réalité ? Comment les violences et ses productions dans plusieurs temporalités ont-elles un impact sur les imaginaires locaux ? Se concentrer sur des traces soit tues et effacées, soit résiduelles de la violence dans les vies quotidiennes, faisant des apparitions improbables dans le présent (p. 9), nous rapproche donc d’une sorte d’archéologie (Navaro 2020) de la violence. Ce travail de réflexion commune développe des méthodologies pour une approche moins anthropocentrées de l’ethnographie. Les co-autrices nous accompagnent dans la compréhension et l’explication, en dénouant patiemment les fils de situations socialement, politiquement et idéologiquement complexes, parce qu’elles s’inscrivent dans des espaces et des temps qui se superposent et parfois se brouillent, ou qui sont restreints par des concepts trop limités. Parce que l’anthropologie est un outil de compréhension des mécanismes du passé dans le présent, cet ouvrage ouvre un champ sur la pluralité de l’histoire et l’imagination d’alternatives pour l’avenir.
[1] Lors du séminaire de l’EHESS « Les “Fêtes de la langue” », organisé par Marc Aymes et Emmanuel Szurek (CETOBaC, EHESS). Cette recension d’ouvrage reprend les éléments de ma discussion lors du séminaire Sociologie politique de la Turquie contemporaine (IFEA / EHESS).
[2] La région de Hatay est marquée par un héritage post-ottoman complexe. On y trouve notamment une présence arménienne persistante, incarnée par le village de Vakıflı — souvent présenté comme le dernier village arménien de Turquie — ainsi que par les ruines des nombreux villages de Musa Dağ / Musa Ler. Ces éléments coexistent avec les survivances d’autres communautés, qui participent elles aussi à la complexité du tissu patrimonial local.
[3] Elle s’est vue remise de ses fonctions en 2025.
[4] https://www.socanth.cam.ac.uk/news/professor-yael-navaro-reverberations-violence-across-time-and-space
[5] « Le fait d’utiliser quelque chose comme moyen d’attaquer une personne ou un groupe » selon Cambridge Dictionary, ou « transformer quelque chose en arme », « instrumentaliser », selon le contexte.
[6] Traductions personnelles.
[7] Victime / coupable, nature / culture, tradition / modernité, superstition / religion, etc.
[8] Souvent associé à Elijah ou St-Georges. Il est une figure spirituelle essentielle à Hatay et aurait rencontré Moïse à un endroit sur la côte, devenu un lieu important de pèlerinage local.
[9] Région frontalière, située au sud de la Turquie et enclavée dans la Syrie, elle fut annexée à la Turquie en 1939.